1er prix, La Maison Trafalgar élue lauréate Or lors de la Nuit de l'Événementiel

Sollicitées pour participer à la Nuit de l’Événementiel – portée par le groupe Républik –, Bérengère et Marion ont été conviées à la remise des prix ce lundi 11 décembre au Matmut Stadium. Toute l’équipe était présente pour découvrir la nouvelle : La Maison Trafalgar est élue lauréate OR du concours !
Quelques semaines plus tôt s’est tenu un grand oral au cours duquel les deux associées ont dû pitcher le bien-fondé du pouvoir de l’écriture dans le monde professionnel et événementiel, et la mission de la Maison. Unanimement séduits par l’énergie de Marion et Bérengère, par les accomplissements de la première Maison d’Écriture haute couture de France et par les entreprises qui nous font confiance pour les accompagner, ce sont vingt-trois jurés, dirigeant·es de sociétés leaders de leur secteur, qui ont sélectionné la Maison Trafalgar comme gagnante de ce concours.
L’écriture en entreprise, une invitée surprise ? Grâce à la décision de la Directrice générale de Boiron, du Président de La Boule Obut, du Directeur général de La Rosée Cosmétiques, de la Directrice générale adjointe de Lavorel Hôtels ou encore du Directeur général des Chocolats Voisin, notre Maison prouve combien l’écriture interpelle, anime, fédère, régale, captive, et qu’elle reprend assurément une place centrale dans l’événementiel.
Expression explicitée : Donner du fil à retordre
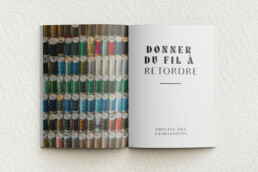
Cette expression souligne une fois de plus la difficulté que demande la maîtrise de certains savoir-faire, en l’occurrence celui du tissage ! Autrefois, il était habituel de tordre différents fils entre eux afin d’en obtenir un plus solide. Une tâche complexe qui demandait de l’expérience, de la patience et beaucoup de minutie ; si bien que la création d’un fil retors digne de ce nom illustre désormais une situation qui a le don de susciter beaucoup de soucis.
Expression explicitée : Reprendre du poil de la bête
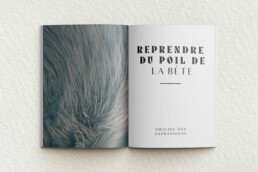
Selon une croyance populaire, le poil d’un animal qui nous a mordu aurait le don de guérir la blessure. Pour combattre le mal par le mal, il suffisait donc d’appliquer sur la plaie les poils de ce même animal. L’expression est restée pour signifier cette nouvelle impulsion que l’on trouve après un échec, lorsqu’on a su se confronter à la cause de ses soucis.
Expression explicitée : Se faire un sang d'encre

Cette expression trouve ses racines dans l’époque médiévale, une époque où la médecine était encore très empreinte de la théorie des humeurs. Selon les observateurs d’alors, le sang était lié à la jovialité. Il était donc admis qu’un fort sentiment d’angoisse et d’inquiétude donnait au sang une teinte plus foncée, si foncée qu’il en deviendrait aussi noir que l’encre !
Expression explicitée : Garder un secret de Polichinelle
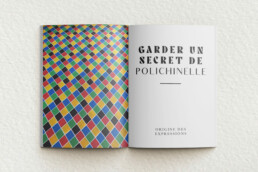
D’Arlequin à Scapin en passant par Scaramouche, nombre de personnages de la commedia dell’arte ont marqué la culture populaire. Et c’est aussi à ce genre de théâtre italien que l’on doit le secret de Polichinelle. Ce valet bedonnant aussi vulgaire que facétieux est aussi connu pour être volubile. Dans l’une de ses aventures, il répand une rumeur auprès des courtisans du royaume sur un seigneur dont le corps serait couvert de plumes, et leur fait promettre de garder le secret. C’est cette frasque qui a donné son sens à la fameuse expression désignant un secret connu de tous… mais que personne n’évoque publiquement !
Tribune : L'étroit couloir du temps présent
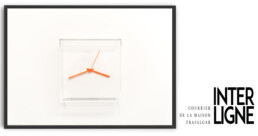
« Il y a deux sortes de temps
Y a le temps qui attend
Et le temps qui espère. »
Jacques Brel, L’Ostendaise
Les conversations quotidiennes ; les interviews, radiophoniques, télévisées ; les témoignages, les récits ; on ne trouve plus guère d’exceptions : afin de provoquer un effet de « direct », le présent de narration a remplacé l’usage des temps passés. Ce que l’on raconte semble ainsi, ce n’est pas surprenant, plus vivant : car le passé est sépulture de ce qui fut ; on n’y compte plus que des morts ; des morts qui, apparemment, font peur, et auxquels on tente donc, comme à des marionnettes, d’insuffler un soupçon de vie pour les faire moins terrifiants, ou plus intéressants qu’ils ne le sont réellement.
Notre présent est par conséquent surpeuplé. Il accueille, recueille le passé, l’absorbe, se laisse remplir de formes disparues. Il était déjà difficile d’accorder de l’espace et des dimensions à ce lieu si fugace qu’on le soupçonne régulièrement de ne pas exister ; il devient plus délicat encore de comprendre comment un temps si étroit pourrait prendre en charge cette multitude d’éléments l’ayant précédé.
Le présent de narration, effet de style bien connu et que notre époque n’a certes pas inventé, est devenu si prépondérant qu’il se vide sous nos yeux de sa substance ; car l’usage régulier d’un effet spécial a pour conséquence de lui ôter tout caractère exceptionnel et donc, de le dénaturer : il passe en effet ainsi de « spécial » à « normal ». Nous ne savourons plus avec le même délice cette espèce de flash-back qui plaçait directement, devant les yeux de l’imagination, les évènements et les faits datés, puisque désormais le langage ne semble plus relever que d’une seule dimension. Or, pour apprécier qu’un objet soit ramené au premier plan, encore faut-il un arrière-plan, une perspective. C’est pourquoi l’usage parcimonieux du présent me semble plus riche que le fait d’y recourir de façon permanente.
Le futur, dimension incertaine du temps et pour cette raison, la plus mystérieuse, pourrait faire l’objet du même sort que le passé. Le présent de futur proche (« j’arrive dans quelques instants ») tire l’avenir vers l’immédiat ; mais on peut entendre parfois des affirmations telles que « Dans cinq ans je suis à la tête de cette entreprise », qui perturbent fortement la frontière entre futur proche, moyen et long termes.
En tous les cas, la disparition progressive du passé, objet d’une fusion-acquisition au profit du présent, tire probablement tout ou partie de ses origines des procédés journalistiques et historiographiques, friands de narration. Sans doute les métiers purement narratifs eux-mêmes s’en sont-ils faits un relai d’importance : les scénarios s’écrivent au présent et les romans eux-mêmes tendent, de plus en plus souvent, à y recourir. Ainsi baignons-nous désormais, à chaque heure de chaque jour, dans un environnement qui n’est pas sans évoquer l’art naïf, que constituent ces tableaux s’affranchissant des lois de l’optique, art qui fut longtemps – et ne l’est plus – considéré comme mineur. Cet art n’est pas sans charme, loin s’en faut : tout son charme tient, précisément, au décalage qu’il impose par rapport aux autres méthodes de représentation picturale. Il semble assez clair que les arts graphiques, comme la littérature, comme les autres arts, tirent leur richesse de leur diversité, et que celle-ci se trouverait considérablement écornée si l’art naïf prenait le pas sur tous les autres.
Quels critères objectifs pourraient nous servir de pierre de touche pour déterminer, parmi les modifications du langage, celles qu’il faudrait condamner ou célébrer ? Aucune évolution de la langue ne doit, en elle-même, attirer nos foudres, au motif – fallacieux – qu’il s’agit de la préserver du changement, ce qui du reste est aussi peu souhaitable que possible. En revanche, il est peut-être dommageable que l’évolution dont traite la présente Tribune consacre une ablation d’une des possibilités offertes par notre système de conjugaisons, plutôt que la transformation d’un usage, ou l’invention d’un nouveau. Qui peut le plus peut le moins – quand la réciproque, cela est bien connu, n’est pas vraie. La naïveté langagière excessive, par laquelle on s’exprime de toute part dans les médias et, par ricochet, dans la vie quotidienne, risque de simplifier excessivement le langage, en sorte qu’il nous soit de plus en plus difficile de nous exprimer clairement. La seule assistance que nous pourrions donc apporter à la parole – qui, notons-le au passage, ne nous demande rien – consisterait à en protéger la capacité à signifier quelque chose. Le cerveau et la conscience humaine étant éminemment complexes, la pensée étant condition de la parole et la parole, celle de la pensée, sans doute est-il important de bénéficier d’une palette d’expression la plus vaste possible. A cet égard, certaines interviews récentes m’ont semblé relativement incompréhensibles : l’absence de perspective ne relève pas que de l’esthétique : elle perturbe parfois considérablement l’intelligibilité d’une narration. Dans ce cas, on peut douter qu’elle soit le fait d’un choix, et redouter qu’elle ne provienne d’une connaissance lacunaire des temps de la langue française.
Tout ceci participe (ou procède ?) de notre société de l’immédiateté que décrivent certains sociologues ; nous plonge, en tous les cas, dans cet univers surpeuplé que j’évoquais à l’orée de cette Tribune. Nous étoufferons bientôt, si nous n’y prenons garde, dans l’étroit couloir du temps présent, qui n’a peut-être pour charge, finalement, que de séparer l’avenir du passé. Nous sommes collés les uns aux autres dans une dimension unique, qui regroupe jusqu’aux grandes figures ancestrales, jusqu’aux morts et aux évènements les plus insignifiants. Nous sommes tout à chaque instant, tous à chaque instant. Dans l’embrasure de notre couloir se presse un flot de vies minuscules ; une infinité d’Hommes sans épaisseur s’adossent aux murs, s’embrassent, se serrent. Les perspectives s’enfuient à contre-courant de la ligne de fuite d’un tableau renaissant. Certes, tout peut donc s’embourber, par le langage, dans les limons d’un cimetière confus, le cimetière des jours sans fin, des nuits lumineuses et des hivers brûlants ; mais tout, par le langage, peut au contraire s’augmenter de couleurs, de vie et de formes, se parfumer d’avenirs, beaux d’être incertains, et de passés, superbes d’avoir été.
Virgile Deslandre
Expert en art oratoire de la Maison Trafalgar
© Matthew Henry
Expression explicitée : Dire à tes souhaits

Avant que cette expression ne devienne une politesse presque machinale, dans la Grèce antique, l’éternuement signifiait qu’un esprit divin était de passage. Il convenait alors de lui exprimer des souhaits pour s’en assurer la protection, et repousser un possible mauvais sort. Si la formule est aujourd’hui adressée directement à la personne qui éternue, c’est qu’elle trouve une seconde origine dans l’épidémie de peste qui ravagea l’Europe du XIVe siècle. Il fallait se dépêcher de dire une bénédiction pour préserver la santé de celui qui éternue, en espérant que ne se cachait pas là un signe de maladie avant-coureur.
Expression explicitée : Dernier cri
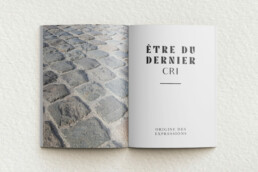
Avant que les télévisions ou les journaux ne diffusent l’actualité en continu, les informations exclusives et autres faits de première importance étaient annoncés par un crieur public, qui arpentait les rues des villes et des villages pour délivrer les nouvelles informations. Des informations qui étaient alors du “dernier cri” !
Expression explicitée : Trier sur le volet
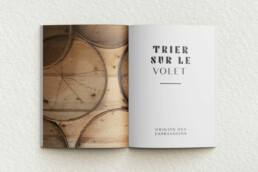
Le volet dont il est question n’est pas celui qui nous plonge dans le noir, mais une sorte de tamis qui permettait de trier les graines. Au Moyen-Âge, le volet était un simple voile ; il prit la forme au XVe siècle d’une tablette en bois, sur laquelle on ordonnait les fèves et les pois. L’expression trier sur le volet est donc restée pour évoquer une sélection méticuleuse, qui tient compte de critères exigeants.
Expression explicitée : Agiter un miroir aux alouettes

Cette expression fait référence à une ancienne technique de chasse permettant de capturer des alouettes. En fixant des bouts de miroir sur un support en bois, les chasseurs provoquaient des reflets en le faisant tourner. L’effet lumineux attirait alors les oiseaux qui, en venant mirer d’un peu trop près, se laissaient prendre au piège ! Ce qui est trop séduisant peut parfois être trompeur.
